(du pinceau à la plume)
la tradition
le lettré
Dans
 un pays où toute la hiérarchie sociale est basée sur la réussite
grâce au savoir, la qualité de
un pays où toute la hiérarchie sociale est basée sur la réussite
grâce au savoir, la qualité de lettré
est particulièrement recherchée.
En réalité, lettrés et mandarins — puisque le mandarin est,
en quelque sorte un ancien lettré qui a réussi aux
examens — constituent ensemble la classe des
văn thân
,
c'est à dire les gens cultivés.
Étymologiquement, comme l'explique l'historien Yoshiharu Tsuboï,
l'expression
văn thân
recouvre la catégorie sociale des lettrés, des notables,
des employés du bureau local et des fonctionnaires en retraite
.
La plupart des membres de cette classe
avaient la même formation socio-culturelle de base,
ajoute-t-il, c'est à dire qu'ils savaient lire et
écrire la langue officielle -le chinois écrit. Les gens
ordinaires, eux, ne connaissaient que la langue parlée,
le vietnamien.
C'étaient donc ces lettrés qui assuraient la transmission au peuple des proclamations officielles. Intermédiaires indispensables, il est arrivé qu'ils jouent un rôle-clé à l'occasion de certains évenements politiques ou sociaux.
 A l'intérieur de ce groupe, le lettré à proprement parler,
A l'intérieur de ce groupe, le lettré à proprement parler,
si nhân
,
est un homme qui a appris la langue et l'écriture chinoise
et qui continue de se cultiver dans ce domaine.
Il se prépare à passer les concours littéraires
et gagne sa vie en enseignant l'écriture et la lecture aux enfants d'un village.
En effet, à peu près dans chaque village, fonctionne une école tenue par un
tu tai
, bachelier,
qui n'a pu obtenir un poste dans l'administration,
ou par un lettré malheureux, refusé aux examens.
La commune lui offrait souvent un champ qu'il cultivait pour son entretien
et chaque enfant lui fournissait une petite cotisation
pour l'huile de la lampe
.
Tout compte fait, le lettré-maître d'école jouissait d'une vie facile,
indépendante et très honorable.

l'enseignant : les écoles de caractères
 Jusqu'en 1919, le gouvernement vietnamien entretenait dans chaque
préfecture et sous-préfecture
(phư
et huyện)
une école dite du 2e degré,
ou tiểu học,
et dans chaque chef-lieu de province
une école dite du 3e degré ou
trung học.
On y étudiait les Quatre livres classiques,
les Cinq livres canoniques, l'histoire et la philosophie.
Jusqu'en 1919, le gouvernement vietnamien entretenait dans chaque
préfecture et sous-préfecture
(phư
et huyện)
une école dite du 2e degré,
ou tiểu học,
et dans chaque chef-lieu de province
une école dite du 3e degré ou
trung học.
On y étudiait les Quatre livres classiques,
les Cinq livres canoniques, l'histoire et la philosophie.
 L'enseignement du premier degré, qui pouvait durer de trois à cinq ans,
consistait à apprendre à lire et à écrire.
Ce premier degré qui constituait ce que l'on appelait la
L'enseignement du premier degré, qui pouvait durer de trois à cinq ans,
consistait à apprendre à lire et à écrire.
Ce premier degré qui constituait ce que l'on appelait la petite étude
,
représentait surtout des préceptes de morale et de politesse,
ainsi que les devoirs sociaux constituant la base de l'éducation en
pays vietnamien.
La grande étude
consistait surtout en l'étude des
Quatre livres classiques
et les
Cinq livres canoniques ainsi qu'un peu d'histoire.
De plus en vue du concours provincial, on initiait l'élève à la versification.
C'est bien plus souvent à quarante ans, ou même plus, que l'étudiant s'affrontait aux concours.
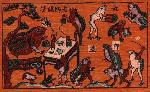 Image humoristique représentant une "école de caractères".
Image humoristique représentant une "école de caractères".

les concours
Supprimés en 1918, les concours ont été pendant plusieurs siècles l'affaire de tous, même s'il y avait peu d'élus. Des concours de préselection avaient lieu assez fréquemment d'abord au niveau de la sous-préfécture ou de la préfecture. Cependant, c'est la réussite aux trois épreuves du concours provincial, thi huong, ou concours général, qui allait permettre, au candidat d'être classés et donc de se présenter aux concours suivants.
Chaque épreuve durant un jour entier,
les candidats travaillaient sous leurs légères tentes,
au camp des lettrés
, et toute communication avec
quiconque leur était interdite.
Les premiers reçus étaient nommés licenciés,
ou cử nhân,
les autres admis, bacheliers ou
tú tài.
Cependant, les lauréats n'avaient pas pour autant accès
aux fonctions administratives.
Pour celà, il fallait passer d'autres concours, à la capitale,
thi hoi,
et au palais royal,
thi dinh.
Les épreuves, cette fois, duraient plusieurs jours.
 Le titre de docteur,
tiên si,
comportait trois degrés.
La dynastie des Nguyễn créa un grade de plus,
celui de
Le titre de docteur,
tiên si,
comportait trois degrés.
La dynastie des Nguyễn créa un grade de plus,
celui de docteur du deuxième tableau
ou
phô bang
Seuls les premiers classés comme docteurs étaient
autorisés à passer l'examen dans le palais même du roi.
S'ils étaient reçus, il devenaient docteurs de première classe
et accédaient aux fonctions mandarinales les plus élevées.
Les docteurs de seconde classe
étaient aussi placés dans
l'administration mais à des fonctions moins importantes.
Vers 1900, des écoles dites de
Hâu bô
ont été crées afin de former les mandarins selon de nouveaux critères.
Les élèves étaient recrutés parmi les lauréats des concours triennaux,
cu nhân
et tu tai,
ainsi que parmi les fils de hauts mandarins.
Ces établissements ont été ensuite transformés en
École des Hautes Etudes Indochinoises
dont les diplômés
étaient nommés chefs de circonscription,
tri huyên,
et, après une période de stage, commis dans les
bureaux des résidences.

un peu d'histoire
L'instruction
 chinoise, destinée à une élite, fut introduite au Vietnam,
entre le 1er et le 2e siècle, à une époque où ce pays était
sous administration directe de la Chine.
chinoise, destinée à une élite, fut introduite au Vietnam,
entre le 1er et le 2e siècle, à une époque où ce pays était
sous administration directe de la Chine.
L'indépendance conquise en 938, avec l'avènement de la dynastie des
Lý (1009-1225)
l'étude des caractères chinois se répandit de façon très importante.
Ce phénomène était lié au developpement du bouddhisme.
Une mission avait en effet rapporté des textes bouddhiques de Chine.
D'ailleurs, une véritable Église bouddhique — ainsi qu'une Eglise taoïque —
avait vu le jour dans ce Vietnam réunifié et désormais indépendant.
En dehors des examens spécifiquement bouddhiques, la Cour des Lý,
puis celle des Trần (1226-1400),
organisèrent des concours dits Tam Giáo
,
c'est à dire des trois doctrines, pour sanctionner l'étude du confucianisme,
du taoïsme et du bouddhisme.
 C'est la culture confucéenne qui connaîtrait, par la suite, une faveur particulière.
Enseignée dans des écoles publiques, et dans de nombreuses écoles privées dans les villages,
les études en seraient sanctionnées par des concours littéraires organisés par l'État.
Ces concours, destinés à faire connaître les lettrés de talent, permettraient de choisir
parmi eux les fonctionnaires qui seraient au service du Roi.
C'est la culture confucéenne qui connaîtrait, par la suite, une faveur particulière.
Enseignée dans des écoles publiques, et dans de nombreuses écoles privées dans les villages,
les études en seraient sanctionnées par des concours littéraires organisés par l'État.
Ces concours, destinés à faire connaître les lettrés de talent, permettraient de choisir
parmi eux les fonctionnaires qui seraient au service du Roi.
Le premier de ces concours littéraires eut lieu en 1075 et distingua dix lauréats. Mais on ne sait guère quelle fut leur fréquence. Au 13e siècle, sous les Trần, ils s'ouvrirent régulièrement tous les sept ans. Peu à peu, on précisa la nature des épreuves, on hierarchisa les grades et les titres.
Ce système fut aboli en 1919. En fait, dès 1913 et surtout à partir de 1920, le mouvement de rénovation de la langue nationale, entrepris par la nouvelle élite, a donné au quốc ngữ un essor tel qu'il a fait disparaître l'usage littéraire du sino-vietnamien et des idéogrammes chinois.

le temple de la littérature
Le Văn Miếu
(文廟)
ou Temple de la Littérature à Hanoi,
 monument dédié aux héros littéraires est probablement d'origine très ancienne.
Situé en plein coeur de la capitale, on s'est longtemps demandé à quand remontait sa première fondation.
Puisqu'il s'agit d'un temple dédié à Confucius, il convient de noter que de telles fondations
étaient toujours en rapport avec l'ouverture de collèges.
Le fait de connaître la date d'origine du
Văn Miếu
renseigne donc sur l'époque d'implantation du système des concours de lettrés.
monument dédié aux héros littéraires est probablement d'origine très ancienne.
Situé en plein coeur de la capitale, on s'est longtemps demandé à quand remontait sa première fondation.
Puisqu'il s'agit d'un temple dédié à Confucius, il convient de noter que de telles fondations
étaient toujours en rapport avec l'ouverture de collèges.
Le fait de connaître la date d'origine du
Văn Miếu
renseigne donc sur l'époque d'implantation du système des concours de lettrés.
 C'est en 1070 que ce temple fut
C'est en 1070 que ce temple fut restauré
dit-on dans les anciennes
Chroniques historiques — il existait donc bel et bien auparavant —
et qu'on érigea des statues de
Confucius (le Maître Antérieur),
de Chou Công (le Saint Antérieur) et de leurs quatre assistants.
Le roi Lý Nhân Tông
y adjoignit en 1076 le
Quốc Tử Giám,
ou Collège des enfants de la nation
destiné d'abord aux seuls princes et fils de mandarins
puis à tous ceux qui avaient satisfait aux examens et parmi lesquels seront recrutés
les fonctionnaires de la nation.

 En 1484, le premières stèles dédiées aux étudiants ayant obtenu un titre de docteur ont été érigées.
On en compte aujourd'hui aujourd'hui quatre vingt deux.
Avec ses cinq cours représentant les cinq éléments naturels,
le site possède une allure grandiose.
La troisième cour est la cour des stèles.
Chacune d'entre elles est posée sur le dos d'une tortue, symbole d'immortalité.
La décoration est particulière en fonction de sa date d'origine.
En 1992, lorsque le site a été entièrement restauré, on a construit
des pavillons qui désormais abritent les stèles et les isolent de l'humidité du sol
par une dalle de béton.
En 1484, le premières stèles dédiées aux étudiants ayant obtenu un titre de docteur ont été érigées.
On en compte aujourd'hui aujourd'hui quatre vingt deux.
Avec ses cinq cours représentant les cinq éléments naturels,
le site possède une allure grandiose.
La troisième cour est la cour des stèles.
Chacune d'entre elles est posée sur le dos d'une tortue, symbole d'immortalité.
La décoration est particulière en fonction de sa date d'origine.
En 1992, lorsque le site a été entièrement restauré, on a construit
des pavillons qui désormais abritent les stèles et les isolent de l'humidité du sol
par une dalle de béton.


phénix, tortue et écriture
le portique et le bassin
La troisième cour est la cour des stèles. Chaque stèle est posée sur le dos d'une tortue, symbole d'immortalité. Chacune est décorée de manière particulière en fonction de sa date d'origine. En 1992, ont été construits des pavillons qui désormais protègent les stèles et les isolent de l'humidité du sol par une dalle de béton.

le mandarin
Le mandarinat forme le cadre général de l'administration.
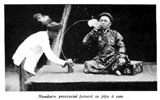 L'accès au statut de mandarin, obtenu par concours, est théoriquement ouvert à chacun.
Tous les lettrés peuvent se présenter aux concours littéraires,
mais seuls ceux qui y sont reçus accèdent au mandarinat et deviennent fonctionnaires.
Leur nombre est infime :
L'accès au statut de mandarin, obtenu par concours, est théoriquement ouvert à chacun.
Tous les lettrés peuvent se présenter aux concours littéraires,
mais seuls ceux qui y sont reçus accèdent au mandarinat et deviennent fonctionnaires.
Leur nombre est infime : une cinquantaine de bacheliers, licenciés et docteurs
tous les trois ans sur quelque dix mille candidats
dit
Lê Thành Khôi
dans son Histoire du Vietnam (p. 355).
Ce système a été pourtant, pendant plusieurs siècles, le moteur véritable de la promotion sociale.
 L'importance des examens et concours était à la mesure des espoirs suscités
dans l'esprit de chacun par la perspective d'une haute position dans la société, d'honneurs
et même de richesse.
L'importance des examens et concours était à la mesure des espoirs suscités
dans l'esprit de chacun par la perspective d'une haute position dans la société, d'honneurs
et même de richesse.
En 1822 les concours de la capitale ont été rétablis par
Minh Mạng et sont ouverts à tous, désormais,
sans distinction d'origine sociale.
C'est la grande innovation démocratique de la dynastie des
Nguyễn.
Tous les candidats subissent les mêmes épreuves.
Les jurys tiennent à leur indépendance par rapport au pouvoir politique.
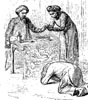
 Dans le peuple, on pense que pour un garçon, c'est l'intelligence qui est la qualité suprême.
Donc le fait d'obtenir le doctorat, de devenir un intellectuel, lettré ou mandarin,
procure un très grand prestige à la famille et au village dont il est originaire.
C'est pourquoi on fête le lauréat par un défilé depuis la capitale jusqu'à son village natal.
Dans le peuple, on pense que pour un garçon, c'est l'intelligence qui est la qualité suprême.
Donc le fait d'obtenir le doctorat, de devenir un intellectuel, lettré ou mandarin,
procure un très grand prestige à la famille et au village dont il est originaire.
C'est pourquoi on fête le lauréat par un défilé depuis la capitale jusqu'à son village natal.

 Les mandarins se répartissent en deux catégories,
les mandarins civils, quan văn,
et les mandarins militaires, quan võ.
Aux quan văn sont dévolues
les fonctions administratives.
Ils coordonnent, surveillent, dirigent : les transports et les échanges,
la construction des routes, l'entretien des digues, s'occupent du calendrier.
A la tête des grandes provinces, il y a un mandarin provincial,
tông dôc.
Pour les provinces moins importantes, c'est un tuân phu.
Sous leurs ordres, exercent les
tri huyên,
les tri phu
et les tri châu.
Les mandarins se répartissent en deux catégories,
les mandarins civils, quan văn,
et les mandarins militaires, quan võ.
Aux quan văn sont dévolues
les fonctions administratives.
Ils coordonnent, surveillent, dirigent : les transports et les échanges,
la construction des routes, l'entretien des digues, s'occupent du calendrier.
A la tête des grandes provinces, il y a un mandarin provincial,
tông dôc.
Pour les provinces moins importantes, c'est un tuân phu.
Sous leurs ordres, exercent les
tri huyên,
les tri phu
et les tri châu.
 Quant aux quan võ,
ils forment la classse des officiers supérieurs et les concours pour les recruter comportent non seulement
des épreuves purement militaires, mais un jury présidé par un mandarin civil
interroge sur des traîtés de tactique et de stratégie.
Quant aux quan võ,
ils forment la classse des officiers supérieurs et les concours pour les recruter comportent non seulement
des épreuves purement militaires, mais un jury présidé par un mandarin civil
interroge sur des traîtés de tactique et de stratégie.

 Mandarins civils comme mandarins miltaires sont soumis à un ensemble de règles rigoureuses,
ces règles et l'ordre
Mandarins civils comme mandarins miltaires sont soumis à un ensemble de règles rigoureuses,
ces règles et l'ordre confucéen
se conjuguant pour souligner
la responsabilité de chacun à quelque niveau hierarchique qu'il se trouve.
L'éducation traditionnelle et le mandarinat ont rempli correctement leur rôle pendant plusieurs siècles.
Néanmoins ils ne sauront pas résister à l'invasion d'une civilisation scientifique,
technique et industrielle qui va les submerger à partir de la deuxième moitié du 19e siècle.
Après une longue période de raideur, et la perte de l'indépendance du pays,
c'est néanmoins au sein de la classe des lettrés qu'un mouvement contestataire
va naître et agir dès les premières années du 20e siècle.

la transition
Au tournant du siècle, la perception d'une transition était perceptible dans l'imagerie populaire.
Le puissant choc culturel, assorti d'affrontements militaires, économiques,
de conquêtes territoriales pour les uns, de perte de l'indépendance et d'humiliations
pour les autres, marque les relations entre l'Orient et l'Occident à partir
du milieu du 19e siècle.
 Dans les pays d'Asie orientale, les réactions de l'élite lettrée ont produit,
en plusieurs générations, une véritable remise en question des valeurs de leurs traditions
par rapport aux valeurs
Dans les pays d'Asie orientale, les réactions de l'élite lettrée ont produit,
en plusieurs générations, une véritable remise en question des valeurs de leurs traditions
par rapport aux valeurs occidentales
synonymes de modernité.
Un vaste débat et de nombreux travaux de recherche sont en cours sur ce thème, actuellement.
A côté des travaux de nombreux historiens vietnamiens,. on notera en France,
d'une part les analyses du sociologue
Trịnh Văn Thảo
relatives à l'évolution des attitudes politiques de trois générations-clé de lettrés
— du confucianisme au communisme —, d'autre part les travaux savants
de l'historien Nguyễn Thế Anh,
enfin les études pertinentes de Yoshiharu Tsuboi.
Au Japon, en Australie, aux Etats-unis, ces questions constituent également
un thème de choix.
L'idée de modernité, le statut de colonisé, les idées sociales, l'engagement dans le combat pour l'indépendance, tous ces thèmes ont été vécus de manière contradictoire par les uns et les autres, dans le sens de la collaboration ou dans celui de l'opposition.
Néanmoins, ce qui a permis aux idées de se répandre
et de gagner des publics de plus en plus vastes, c'est le développement de l'écrit
imprimé couplé à la modernisation de la langue.
Ainsi de la presse en chinois, dès la deuxième moitié du 19e siècle,
on est passé à l'écrit en quốc ngữ
— et en français — qui représente, vers 1930, plus de 90% des publications.
Entre ces deux époques, trois générations de conjoncture
,
selon l'expression de Trịnh Văn Thảo,
c'est à dire 1862, 1907, 1925.
La grande question pour cette période de l'histoire vietnamienne — objet de discussions passionnées — est-elle celle de la scission entre intellectuels patriotes et intellectuels collaborateurs ou la marque de la rupture entre intellectuels classiques et intellectuels nouveaux, produits du système scolaire colonial ?




