(des estampes à l'ordinateur)
religion et médias
introduction
On entend souvent dire qu'au Vietnam, ce sont trois religions qui sont pratiquées. L'usage courant de l'expression tam giáo, les trois religions, c'est à dire le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme, 儒 Nho, 佛 Phật, 老 Lão, consacre l'importance que les Vietnamiens ont toujours entendu donner à ces grands courants de la pensée chinoise.
En effet, l'adoption et la pratique intime de l'écriture et de la langue littéraire chinoises comme forme d'expression ont eu pour effet de faire passer doctrines, croyances, religions d'origine chinoise, principalement le confucianisme et le taoïsme, dans une culture vietnamienne préexistante.
Pour le bouddhisme, même s'il est venu par l'Inde,
c'est malgré tout l'école du grand véhicule
,
大乘
đại thừa,
ou mahāyāna,
qui a transmis dans leur version chinoise les textes du canon sanscrit.
La vie intellectuelle, les comportements sociaux et les attitudes mentales
ont donc été marqués par la culture chinoise plus que par aucune autre.
En réalité, en grande majorité, les Vietnamiens ont adopté une sorte de religion
très souple,
qui emprunte, mêlées à des croyances, à des attitudes mentales originaires du sol vietnamien,
des pratiques rattachées les unes au confucianisme, d'autres au bouddhisme ou au taoïsme.
Ces croyances et ces pratiques font partie de la culture telle qu'elle est encore aujourd'hui,
avec, au centre, le culte des ancêtres ainsi que celui des génies tutélaires aux temples des villages.

les "trois religions" : confucianisme, bouddhisme et taoïsme
La doctrine bouddhique, Phật học, est exprimée dans une masse considérable de textes. Selon l'école à laquelle ils se rattachent, ces textes ont été rédigés soit en hán soit en pāḷi.
Quant aux premiers livres classiques bouddhiques qui furent introduits au Vietnam ils ne vinrent probablement pas de Chine, comme on l'a longtemps pensé, mais de l'Inde méridionale. Des hypothèses récentes permettent en effet d'imaginer que le Centre bouddhique de Luy Lâu au Giao Châu a sans doute servi de relais de diffusion - dès le 2ee siècle - de certains textes du bouddhisme vers la Chine puis de centre de traduction de ces textes.
Aujourd'hui, pour les textes en chinois, qui relèvent du grand véhicule
ou
mahāyāna
- on dit désormais
bắc tông plutôt que
đại thừa -
comme pour les textes en pali du
theravāda,
l'école dite du sud
,
nam tông,
on dispose d'éditions traduites et publiées en quốc ngữ.
La diffusion de ces traductions a connu un essor considérable, mais tardif.
Celles des textes chinois ne semblent apparaître que vers la fin des années 1930.
Pour le canon pāḷi,
il faut attendre 1950.
Il faut constater pourtant le décalage important entre ce que représentait ce projet éditorial c'est à dire la volonté de fixer et faire mieux connaître la vraie tradition, avec ce qui se passait vraiment dans le quotidien. Dans la pratique de la vie religieuse, les prescriptions des livres religieux et surtout des livres bouddhiques étaient et sont demeurées purement théoriques. Elles ne sont jamais appliquées ou suivies à la lettre, pas plus par le peuple que par les classes aisées ou même lettrées. L'examen du mobilier d'une pagode, la lecture des prières ou l'observation d'une cérémonie, suffisent pour être convaincu que les diverses religions importées au Vietnam se sont mutuellement emprunté leurs divinités respectives, des parties importantes de leurs rituels, jusqu'à des formules de prières. On voit par exemple les divinités stellaires du taoïsme à côté de l'image du bouddha. A l'inverse, dans les prières des taoïstes, sont invoqués les esprits protecteurs du bouddhisme. On y ajoutera les cérémonies et les rituels du culte des Immortels. Les sorciers, c'est à dire les đồng, les zoochiromanciens, les géomanciens, les évocateurs du tigre, etc. récitent des formules sanscrites empruntées aux livres bouddhiques concuremment avec les citations de Lao Tseu.

les chrétiens
L'écriture chinoise, avec ses aspects magiques, a été utilisée pendant des siècles à traduire la pensée vietnamienne. Au 20e siècle, l'adoption de l'écriture latine alphabétique, en lieu et place des idéogrammes traditionnels, ne semble pas avoir posé de problèmes insolubles. Pourtant cette écriture latine a été mise au point et introduite à partir du 17e siècle par des chrétiens, c'est à dire des représentants d'une religion qui a presque toujours été combattue non seulement par le pouvoir central mais encore par les lettrés, donc l'élite intellectuelle du pays. Or c'est cette élite lettrée mais contestataire qui, au début du 20e siècle, et à la suite d'un processus de maturation relativement court, a compris que l'adoption du quốc ngữ et la généralisation de l'écriture latine allait opérer une véritable refondation de la langue nationale afin d'en faire une langue adaptée aux exigences de la modernité. De nombreux ouvrages en vietnamien ont été publiés par les presses missionnaires à Tân định, près de Saigon, à Ke sô ou à Hanoi. L'œuvre d'enseignement fut également importante.

une secte : le caodaïsme
De nos jours, les touristes, en arrivant à la province de Tây Ninh, à une centaine de kilomètres au nord de Ho-Chi-Minh-ville, s'étonnent de voir une église majestueuse, d'une architecture mi-orientale, mi-occidentale.
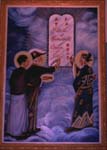 A l'entrée, en haut du portail, on voit un grand tableau de
trois saints caodaïstes qui assumèrent la charge de signer avec Dieu
un contrat pour la Troisième Amnistie.
A l'entrée, en haut du portail, on voit un grand tableau de
trois saints caodaïstes qui assumèrent la charge de signer avec Dieu
un contrat pour la Troisième Amnistie.
Ces trois Saints sont trois personnages renommés originaires de trois pays différents.
Il s'agit de
Nguyễn Bỉnh Khiêm,
poète et astrologue vietnamien,
Sun Yat Sen,
révolutionnaire chinois
et Victor Hugo, l'écrivain français.
 La religion dont on célèbre ici le culte est née en 1926.
Selon ses fondateurs, à cause de la multiplicité des religions existantes,
les hommes n'ont pas toujours vêcu en harmonie.
Dieu a donc accordé à l'humanité une Troisième — et sans doute dernière — chance de salut.
La religion dont on célèbre ici le culte est née en 1926.
Selon ses fondateurs, à cause de la multiplicité des religions existantes,
les hommes n'ont pas toujours vêcu en harmonie.
Dieu a donc accordé à l'humanité une Troisième — et sans doute dernière — chance de salut.
Il a choisi le Vietnam comme premier lieu afin d'y envoyer ses instructions.
Grande voie du salut de la troisième époque du jeûne qui délivre les âmes restées captives aux enfers
,
Đại Đạo Tam Kì Phổ Độ,
tel est le nom que s'est donnée cette nouvelle foi.
Les caodaïstes nomment aussi cette délivrance Amnistie
.
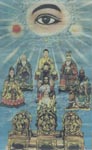 Les murs et la coupole sont décorés de fresques dont les motifs renvoient au syncrétisme des pratiques caodaïstes :
culte des ancêtres, bouddhisme, taoïsme, confucianisme ou christianisme.
Les murs et la coupole sont décorés de fresques dont les motifs renvoient au syncrétisme des pratiques caodaïstes :
culte des ancêtres, bouddhisme, taoïsme, confucianisme ou christianisme.
Sur les autels, il en est de même.
Ainsi, on peut voir au premier rang,
Cakyamuni,
Confucius,
Laotseu
et au second rang, la déesse
Quan Âm
(Avalokiteçvara),
Li Tai Po
le poète chinois
(Lý Thái Bạch en vietnamien)
en tant que pape spirituel
,
Quan Công
(le Turenne chinois),
puis, au troisième rang,
le Christ au Sacré-cœur,
enfin au quatrième rang,
Khương Thái Công, le chef des génies.
L'œil est partout, central. Il représente la divinité, Cao Đài, l'Être Suprême, le Seigneur de la lumière et des ténèbres.
C'est probablement le même œil symbolisant la Franc-maçonnerie française qui,
par des liens étroits avec les fondateurs du caodaïsme,
représente ici aussi les principes de fraternité universelle
.
 La période au cours de laquelle le caodaïsme est apparu au Vietnam est marquée
par l'affaiblissement de la culture chinoise au profit de l'éducation à l'occidentale.
Les fondateurs, devenus ensuite les dignitaires de cette nouvelle religion,
se sont révélés dès le début plus familiers des alphabets latins que des idéogrammes chinois.
Cependant, tout en portant leur choix sur le quốc ngữ comme moyen de communication,
ils ont voulu maintenir le hán, utilisé, en réalité, à titre plutôt
La période au cours de laquelle le caodaïsme est apparu au Vietnam est marquée
par l'affaiblissement de la culture chinoise au profit de l'éducation à l'occidentale.
Les fondateurs, devenus ensuite les dignitaires de cette nouvelle religion,
se sont révélés dès le début plus familiers des alphabets latins que des idéogrammes chinois.
Cependant, tout en portant leur choix sur le quốc ngữ comme moyen de communication,
ils ont voulu maintenir le hán, utilisé, en réalité, à titre plutôt décoratif
.
Quant aux sentences parallèles, elles sont, le plus souvent, présentées en quốc ngữ.
Le rôle de l'écriture, dans cette religion basée sur le spiritisme, apparaît fondamental. C'est véritablement l'écriture, la parole notée selon un technique bien particulière, qui sert d'intermédiaire entre l'homme et les esprits.
En effet, l'Etre suprême,
Cao Đài,
se manifeste de manière directe dans les séances de médiums.
L'outil de communication avec les esprits, c'est à dire l'outil de lecture et d'écriture
était au début la table frappante, inspirée du spiritisme européen.
Ensuite on préféra la corbeille à bec
, un instrument utilisé autrefois par les anciens lettrés
lorsque les esprits
leur dictaient des vers contenant des allusions prophétiques.
La table d'alphabet, inspirée sans doute des syllabaires latins que l'imprimerie en quốc ngữ à ses débuts diffusait avec complaisance, est une véritable innovation des fondateurs du Caodaïsme. Sa conception devait permettre d'accélérer la vitesse des communications avec les esprits.
L'emploi de l'alphabet pour la transcription des mots des messages reçus des esprits a consacré l'usage du quốc ngữ - et du français - dans les textes canoniques. Ceux-ci, le catéchisme, les livres de prière, les cantiques, captés directement en quốc ngữ sous forme de messages spirites grâce à la table d'alphabet, ont pour origine des écrivains du monde des vivants devenus Saints dans le caodaïsme comme Li Tai Po, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đoàn Thị Điểm, Victor Hugo, Chateaubriand, La Fontaine, Shakespeare…

L'écriture, moyen unique de communication et de transmission des messages divins devient ainsi sacrée.
Les outils qui servent à capter ces messages sont, eux aussi, considérés comme sacrés.
C'est le quốc ngữ qui sera le grand bénéficiaire de la diffusion de la doctrine. Néanmoins, l'usage des idéogrammes est maintenu, pour la forme. Il s'avère plus que restreint. Vêtements ou chapeaux des grands dignitaires en sont parfois agrémentés.
Ainsi on leur préfére souvent d'autres motifs. Sur le vêtement du Pape, Giáo Tông, figurent les huit trigrammes de Phục Hy.
L'œil qui est le symbole de la Divinité suprême et signifie omniprésence
,
omniscience
ou conscience
se trouve sur les vêtements des grands dignitaires.

Des dragons qui s'envolent vers le ciel sont sculptés autour des colonnes
dans les églises caodaïques pour désigner une relation intime et mystique
entretenue dans ces lieux entre la terre et le ciel.
Ce motif de dragon décore aussi les habits de Hộ Pháp Phạm Công Tắc, l'un des fondateurs et pendant de nombreuses années le plus important dignitaire du caodaïsme.
Dans les revues bilingues - français et vietnamien - de l'Institut caodaïque, l'organisme chargé de la propagation de cette religion, le français est souvent présent, mais le quốc ngữ prime nettement. D'ailleurs, les caractères en quốc ngữ sont présentés dans un corps plus gros et sont toujours mis en relief d'une façon ou d'une autre.
Sur les cachets, c'est un autre biblinguisme qui est pratiqué. Les lettres sont gravées en général en caractères chinois et en quốc ngữ. Une exception à cette habitude, le cachet du Hộc PhápPhạm Công Tắc où seuls des caractères chinois sont gravés.
Le caodaïsme rêvait d'un monde où se rejoindraient l'Orient et l'Occident.
Cet espoir d'un symbiose des deux cultures exprime à la fois la soif de modernisme
et le maintien d'un certain traditionalisme qu'on retrouve alors
chez la plupart des intellectuels vietnamiens des années 1920.
Cette nouvelle religion, si rapidement populaire, a su utiliser avec réalisme
les capacités de diffusion de sa doctrine grâce au quốc ngữ,
dans un nouveau marché du livre où les possibilités offertes par la typographie
sont un facteur ressenti comme positif.
En 1945, il y avait presque trois millions d'adeptes.
De nombreuses sectes ont vu le jour durant la première moitié du vingtième siècle
dans le sud du Vietnam en particulier.
Parmi elles, c'est le caodaïsme qui a obtenu le plus grand rayonnement,
réussissant à s'implanter au delà du Vietnam, jusqu'au Cambodge
où, il est vrai, résidaient de nombreux vietnamiens.
Pourtant, à la suite de luttes internes, de l'émergence de sectes concurrentes, de prises de position politiques ou de changements de régime, le caodaïsme a perdu peu à peu beaucoup de ses adeptes. Actuellement, il s'est scindé en plusieurs sous-sectes mais c'est encore le Saint-siège de Tây Ninh qui reste le symbole vivant du caodaïsme au Vietnam.
Deux thèses importantes dont l'une est récente : Pierre Bernardini. Le Caodaïsme au Cambodge.(Univ.Paris VII, 1974) Trần Thu Dung. Le Caodaïsme et Victor Hugo (Univ. Paris VII, 1996).






